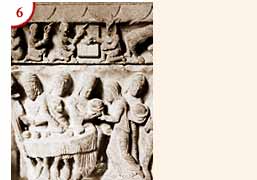|
Cathédrale Saint-Etienne L'extérieur |
|
La
principale originalité de la cathédrale est de présenter
deux parties très distinctes, construites à des époques différentes
avec des styles architecturaux différents.
Jusqu'au XIIIe siècle, les plans de l'église romane d'origine furent sans cesse modifiés. Ainsi, une révision de la hauteur prévue de l'édifice est visible par la coupe des fenêtres sur le mur sud, tandis que le mur nord, construit plus tard, ne présente pas cette anomalie. La façade ouest (photo 1) donnant sur la place Saint-Etienne et qui date de 1217 est écrasée par un " clocher-donjon " massif de 55m de haut (photo 1 & 3). Deux contreforts en brique la soutiennent. Le double portail de style gothique flamboyant, construit par Marin Baudry, est curieusement décentré vers la droite (photo 1). Il est couronné par une rosace datant de 1230, construite selon l'aspect de celle de Notre-Dame de Paris (photo 2). Le flanc nord de la cathédrale (photo 3), de 105m de long, témoigne parfaitement de cette juxtaposition des deux styles architecturaux. C'est particulièrement visible si l'on se place à l'angle de la rue de Metz et de la rue Riguepels, en regardant vers le sud. La nef d'Isarn, à l'ouest, construite dans le style gothique méridional et le choeur, à l'est, dans le style gothique septentrional. Cette façade est ornée en son centre d'un portail majestueux. |

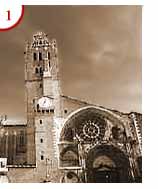


|
Ces deux parties furent reliées au XVIe siècle par Jean
d'Orléans. Le square actuel résulte de la démolition d'un groupe
de maisons qui couvraient tout le flanc nord de la cathédrale.
L'arrière du bâtiment, ou abside, (photo 4) est orientée, comme dans la plupart des églises chrétiennes, vers l'Orient. Quant au côté sud de la cathédrale (photo 5), il jouxtait un cloître aujourd'hui disparu. Edifié sur le modèle de celui de Moissac à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, il était situé entre la cathédrale et l'église Saint-Jacques. Sa forme était à peu près carrée, les côtés faisant environ 51 mètres. Sa façade orientale comportait une sacristie et une salle capitulaire. L'ensemble fut détruit en 1812 et il ne subsiste que des chapiteaux exposés au Musée des Augustins (photo 6). |